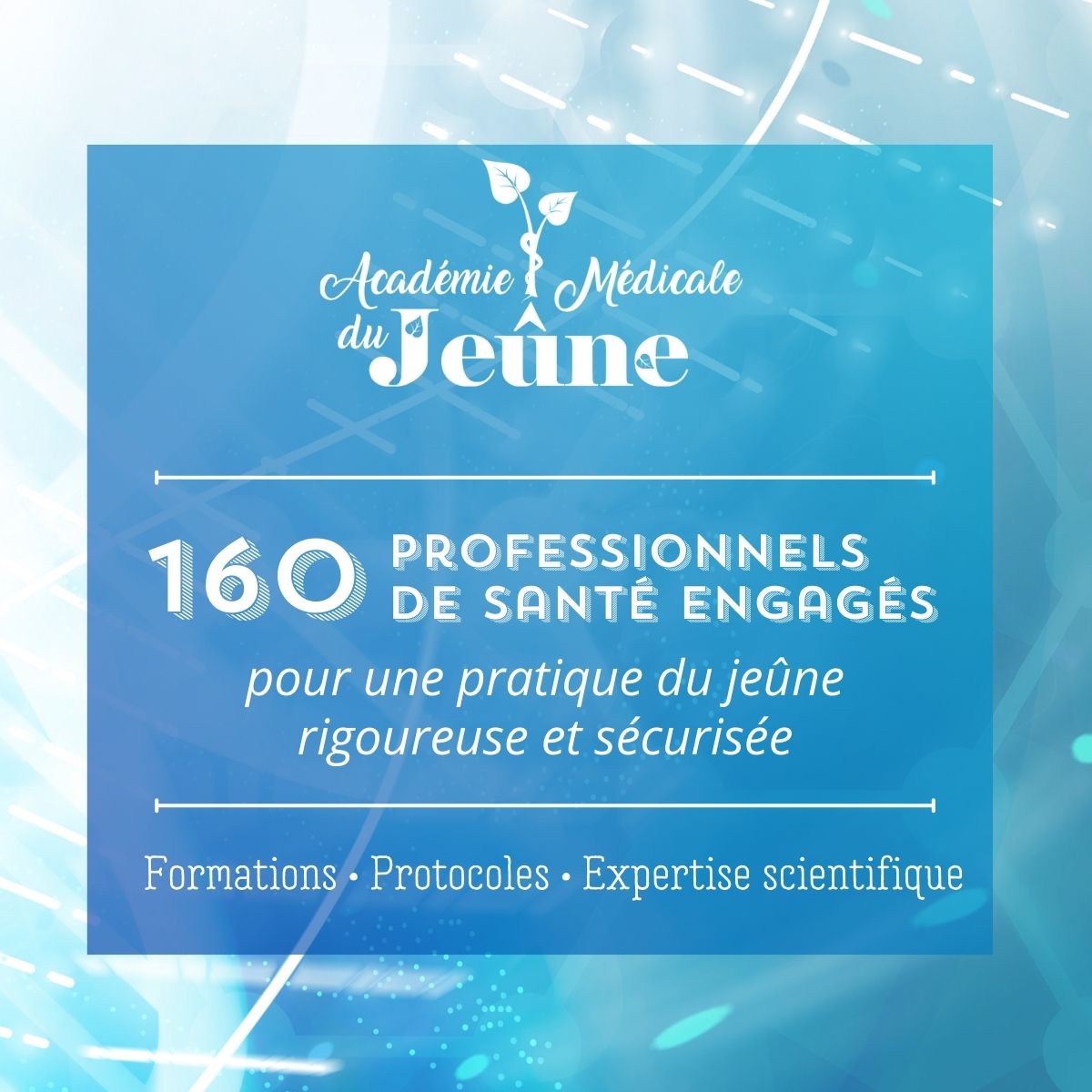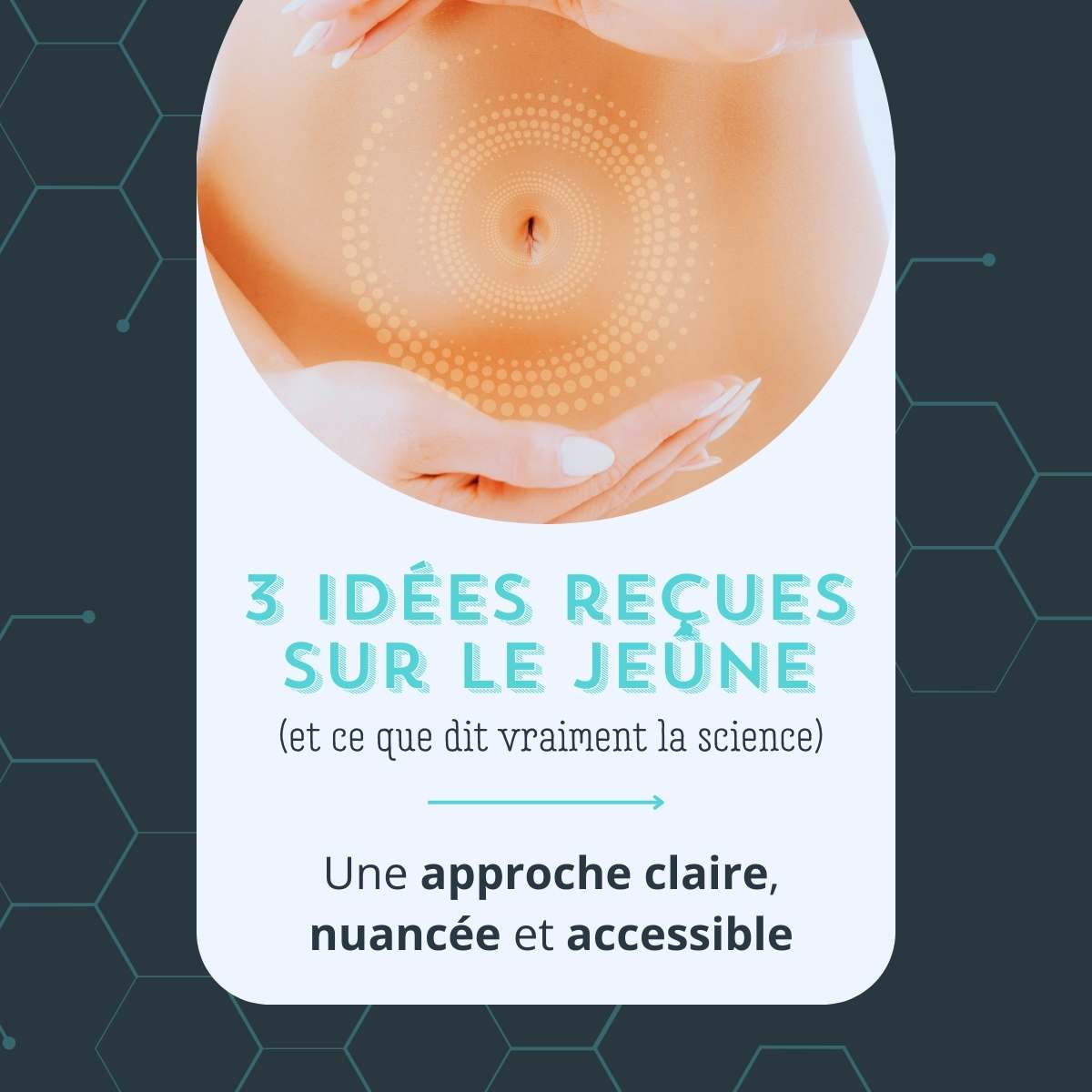
3 idées reçues sur le jeûne : ce que la science confirme… et ce qu’il faut vraiment nuancer
Le jeûne attire de plus en plus l’attention du grand public, notamment avec la popularité du jeûne intermittent. Mais cette pratique reste entourée d’idées reçues : “dangereux”, “fatigant”, “source de carences”, “perte de muscle”…
Autant d’affirmations qui méritent d’être éclairées. Les recherches menées par des équipes scientifiques permettent d’y voir plus clair.
Cet article propose un éclairage simple, accessible et rigoureux, pour mieux comprendre ce que le jeûne fait réellement… et ce qu’il ne fait pas.
Jeûne préventif vs. jeûne thérapeutique : deux pratiques distinctes
Avant toute chose, il est important de distinguer le jeûne préventif, destiné aux personnes en bonne santé et visant le bien-être général (régulation du métabolisme, vitalité, réduction de l’inflammation…), du jeûne thérapeutique, qui relève d’un accompagnement médical.
Ce dernier concerne certaines pathologies métaboliques ou inflammatoires et doit souvent être encadré par un médecin si médication, avec un protocole adapté et un suivi rigoureux.
En résumé :
- Prévention = public en bonne santé ou absence de médicaments
- Thérapeutique = suivi médical obligatoire

Idée reçue n°1 : “Le jeûne est dangereux / tu vas te carencer”
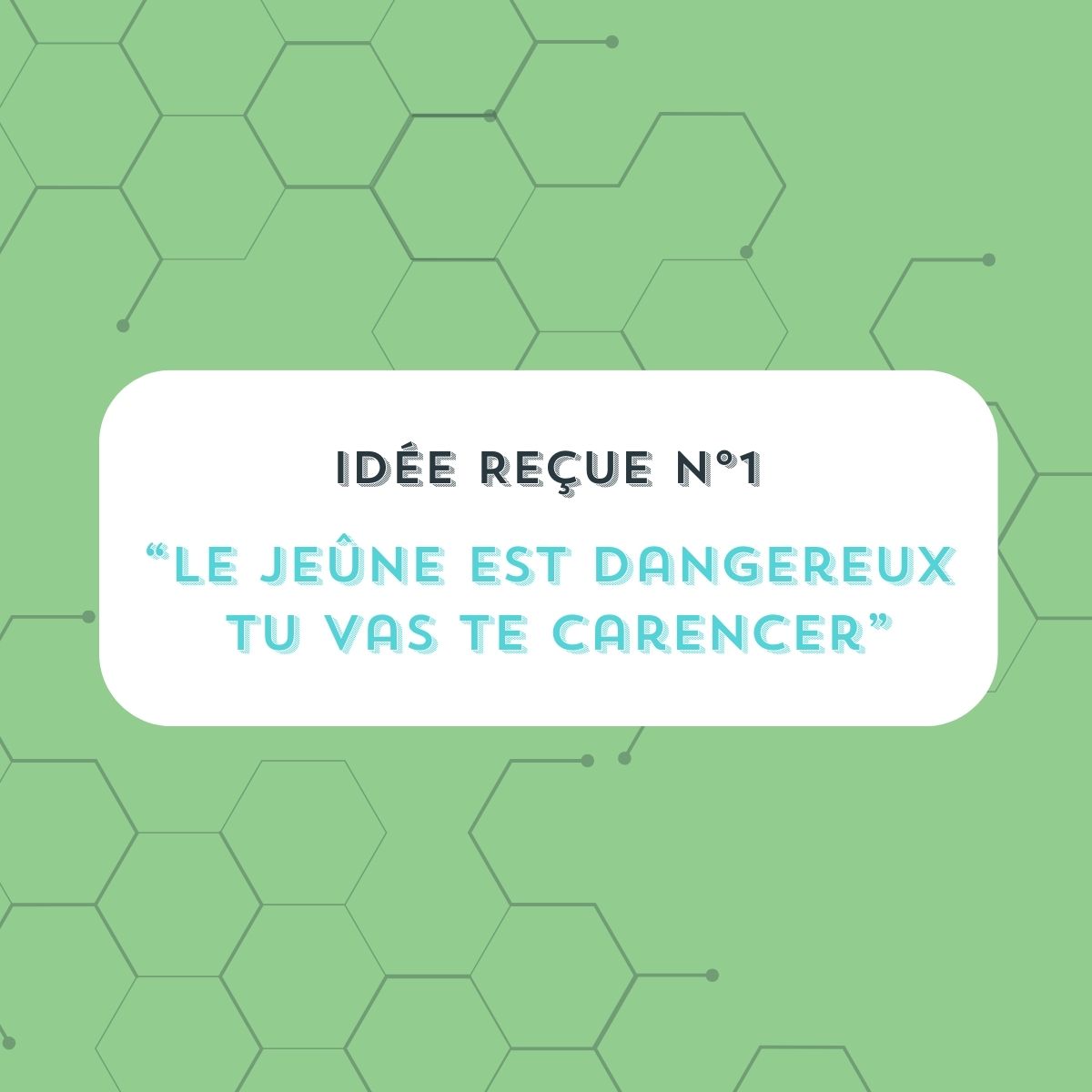
Cette idée revient fréquemment : « Ne pas manger est dangereux », « Tu vas manquer de vitamines », « Ton corps va s'affaiblir ».
Tout d’abord :
Ce que disent les études
Lors d’un jeûne, le corps bascule naturellement vers un système d’économie et de redistribution des réserves. Il s’agit d’un phénomène physiologique, documenté notamment par les travaux menés à la Charité de Berlin ou encore par les études des Cliniques Buchinger-Wilhelmi.
✔ Ce qu'il faut nuancer
Le jeûne n’est pas adapté à tout le monde.
Il existe des contre-indications. Parmi elles :
- Les contre-indications strictes
Ce sont des situations où le jeûne est formellement déconseillé :
grossesse, allaitement, troubles du comportement alimentaire, carences sévères, certaines pathologies métaboliques ou psychiatriques, traitements nécessitant une alimentation régulière, insuffisance rénale ou hépatique sévère…
https://academie-medicale-du-jeune.fr/professionnels-de-sante/les-indications-et-contre-indication-du-jeune/
- Les contre-indications relatives
Ce sont des situations où le jeûne peut être envisagé, mais uniquement avec avis et/ou suivi médical : diabète bien contrôlé, hypertension, maladies inflammatoires, fatigue chronique, prise de certains médicaments…
Ici, l’évaluation individuelle est indispensable.
En résumé :
Certains profils ne doivent pas jeûner, d’autres peuvent le faire avec prudence et encadrement, et les personnes en bonne santé peuvent envisager un jeûne préventif bien conduit et de préférence pour éviter tout risque bien encadré
Source : Safety, health improvement and well‑being during a 4 to 21‑day fasting period in an observational study including 1422 subjects — F. Wilhelmi de Toledo et al., PLOS ONE, 2019.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0209353
Idée reçue n°2 : “Le jeûne affaiblit”
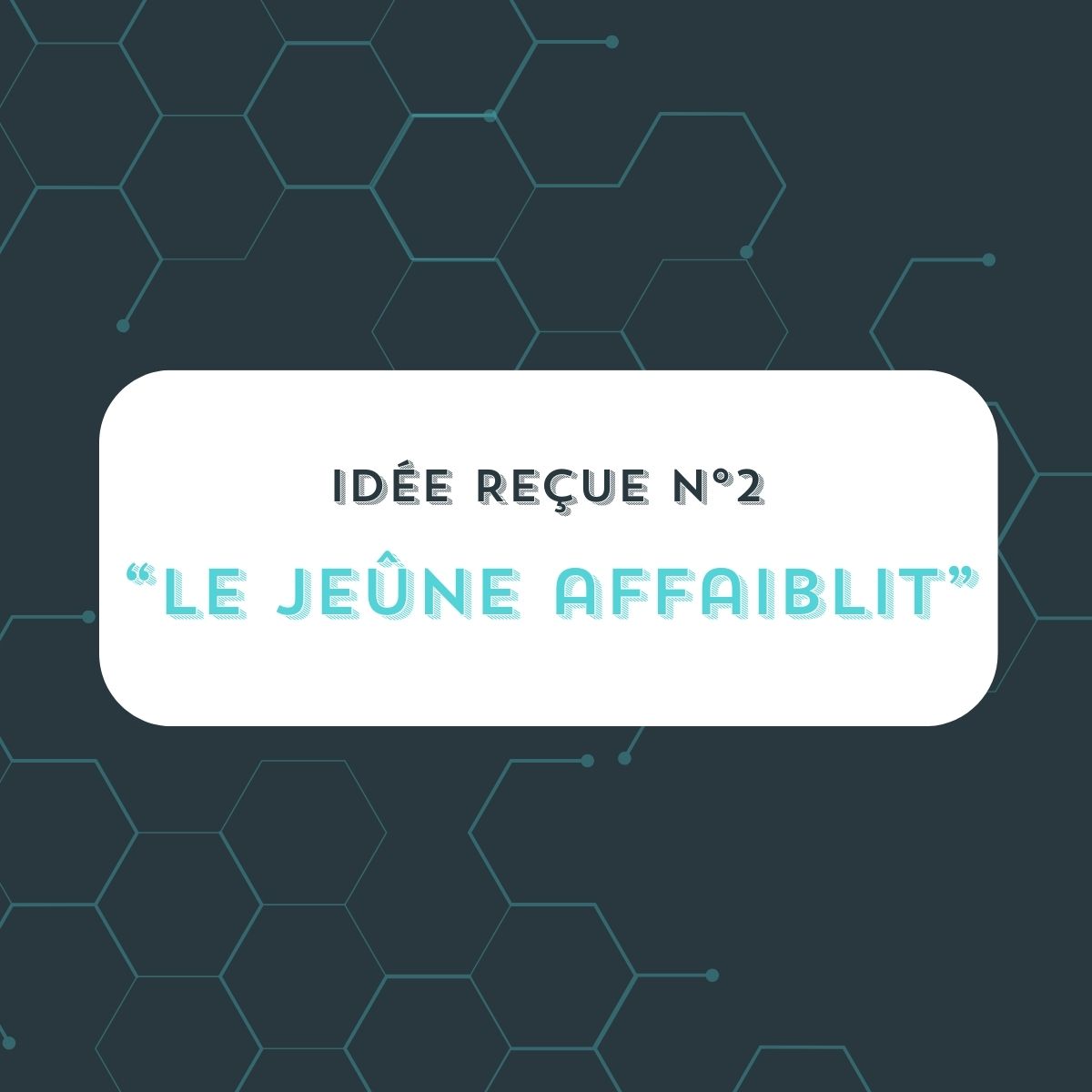
Beaucoup pensent qu’un jeûne provoque une baisse d’énergie durable.
La réalité est plus subtile.
La phase d’adaptation existe (bascule métabolique)
Durant les 24 à 72 premières heures :
- La glycémie s’ajuste
- Le corps change de carburant
- La sensation de fatigue et d'autres symptômes d'adaptation peuvent être présent.
Cette transition est normale.
Puis une autre dynamique apparaît
Les observations cliniques et l’expérience de terrain montrent que, passé ce cap :
- La clarté mentale s’améliore,
- La vitalité est souvent augmentée,
- L’humeur devient plus régulière.
Ce phénomène est régulièrement rapporté dans les cures de jeûne encadrées, mais aussi dans le jeûne intermittent, lorsqu’il est pratiqué avec discernement.
Idée reçue n°3 : “Le jeûne fait perdre du muscle”
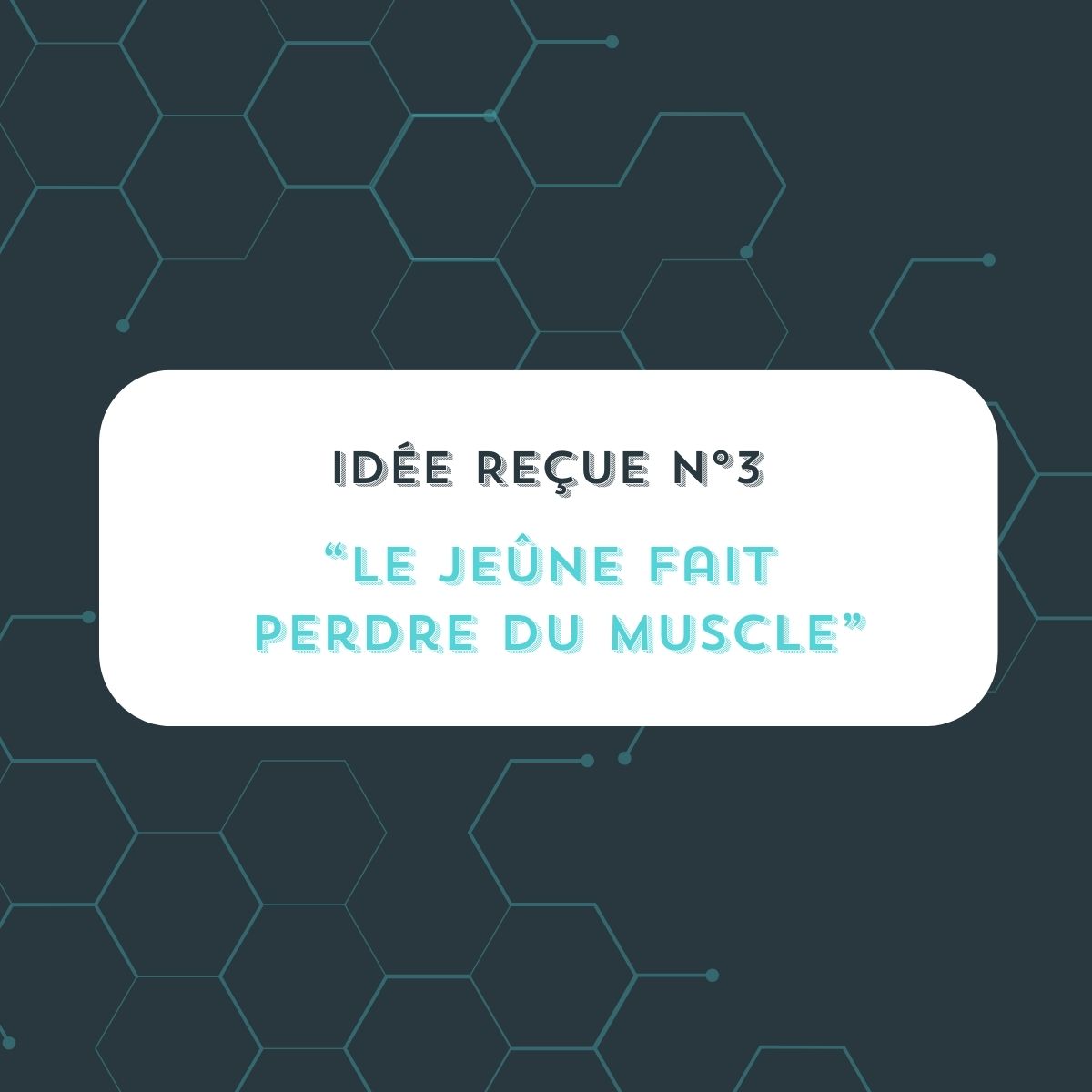
C’est probablement l’idée reçue la plus persistante… et pourtant l’une des plus contredites par la science.
✔ L’étude GENESIS : un tournant scientifique
L’étude GENESIS, menée avec des chercheurs du CNRS, a suivi 32 participants réalisant un jeûne de 12 jours.
Les conclusions sont sans ambiguïté :
- Aucune perte musculaire,
- Aucune perte de force,
- Structure musculaire préservée,
- Résultats confirmés par plus de 70 000 images IRM par participant (un protocole exceptionnel).
Cette étude a été présentée dans le documentaire ARTE de Février 2025
? « Le jeûne, enquête sur un phénomène »,
signe de son importance et de sa robustesse méthodologique.
✔ Pourquoi le muscle est-il préservé ?
Parce que le corps :
- Active la lipolyse (utilisation des graisses),
- Produit des corps cétoniques (carburant alternatif),
- Économise naturellement les protéines.
Le mythe de la fonte musculaire est aujourd’hui largement contredit par les données scientifiques.
Source : Long‑term fasting: Multi‑system adaptations in humans (GENESIS) — étude inter-disciplinaire (2022) sur les effets d’un jeûne long, avec imagerie et suivi métabolique.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9713250/
Page de présentation de l’étude GENESIS sur le site de Cliniques Buchinger‑Wilhelmi :
https://www.buchinger-wilhelmi.com/en/fasting-muscle-loss/
Le point essentiel : jeûner oui… mais pas pour tout le monde, et pas n’importe comment
Le jeûne, dans ses différentes formes (intermittent, bien-être ou thérapeutique) peut être un outil puissant. Mais il doit toujours être abordé avec sécurité, nuance et individualisation.
✔ À retenir :
- Le jeûne n’est pas dangereux lorsqu’il est adapté et bien maîtrisé
- Il existe des contre-indications : elles doivent être connues.
- Les bénéfices apparaissent lorsqu’il est approprié et bien conduit.
Envie d’aller plus loin ? Le 2ème Congrès International du Jeûne 2026
Ces questions seront au cœur du
2ᵉ Congrès International du Jeûne
? 7 & 8 mars 2026 — Paris & en ligne
Pendant deux jours, médecins, biologistes, chercheurs et praticiens venus de plusieurs pays expliqueront :
- Les mécanismes du jeûne,
- Ses bénéfices et ses limites,
- Sa place dans la prévention,
- Comment jeûner en sécurité,
- Ce que disent vraiment les études scientifiques.
-> Programme & inscriptions : https://www.lecongresdujeune.com/
Foire aux questions – Jeûne, prévention et santé
Le jeûne intermittent est-il dangereux pour la santé ?
Chez une personne en bonne santé, un jeûne préventif bien conduit (dont le jeûne intermittent) n’est pas considéré comme dangereux en soi : le corps dispose de mécanismes physiologiques d’adaptation qui lui permettent de mobiliser ses réserves et de changer de carburant énergétique. Les études menées à la Charité de Berlin et dans les cliniques Buchinger-Wilhelmi montrent que le jeûne encadré peut être sûr, avec des effets positifs sur certains marqueurs métaboliques et inflammatoires.
En revanche, le jeûne n’est pas adapté à tout le monde et peut être à risque en cas de carences, de traitement médicamenteux ou de pathologies. Avant de mettre en place un jeûne, il est recommandé d’en parler avec un professionnel de santé, surtout si vous avez un terrain fragile ou une maladie chronique.
Quelle est la différence entre jeûne préventif et jeûne thérapeutique ?
Le jeûne préventif s’adresse à des personnes en bonne santé et s’inscrit dans une démarche de bien-être global : régulation du métabolisme, vitalité, réduction de l’inflammation de bas grade. Il peut prendre la forme d’un jeûne intermittent ou de courtes périodes de jeûne encadré.
Le jeûne thérapeutique, lui, relève d’un accompagnement médical. Il concerne certaines pathologies métaboliques ou inflammatoires et doit être intégré à une prise en charge globale, avec protocole personnalisé, suivi clinique et prise en compte des traitements en cours. Il ne doit pas être entrepris seul.
Qui ne devrait pas jeûner ? (contre-indications strictes et relatives)
On distingue les contre-indications strictes et les contre-indications relatives. Les contre-indications strictes correspondent à des situations où le jeûne doit être évité : grossesse, allaitement, troubles du comportement alimentaire, carences sévères, certaines pathologies métaboliques ou psychiatriques, insuffisance rénale ou hépatique sévère, traitements nécessitant une alimentation régulière.
Les contre-indications relatives sont des situations où un jeûne peut éventuellement être envisagé, mais uniquement avec l’avis et le suivi d’un médecin : diabète bien contrôlé, hypertension, maladies inflammatoires, fatigue chronique, prise de certains médicaments. Dans tous les cas, une évaluation individuelle est indispensable avant d’envisager un jeûne.
Le jeûne affaiblit-il l’organisme ?
Lors d’un jeûne, il existe généralement une phase d’adaptation de 24 à 72 heures pendant laquelle la glycémie s’ajuste, le métabolisme change de carburant et des sensations de fatigue ou d’inconfort peuvent apparaître. Cette transition est normale et correspond à la bascule métabolique.
Au-delà de cette phase, les observations cliniques et l’expérience de terrain montrent souvent une amélioration de la clarté mentale, une énergie plus stable et une humeur plus régulière, notamment dans le cadre de jeûnes encadrés ou de jeûne intermittent pratiqué avec discernement. Le jeûne n’“affaiblit” pas mécaniquement l’organisme : tout dépend du contexte, du profil de la personne et du cadre dans lequel il est pratiqué.
Le jeûne fait-il perdre du muscle ?
Contrairement à une idée reçue tenace, les données scientifiques disponibles montrent que le jeûne bien encadré ne conduit pas nécessairement à une perte musculaire. L’étude GENESIS, menée avec des chercheurs du CNRS, a suivi des participants jeûnant pendant 12 jours : elle n’a pas mis en évidence de perte de masse musculaire ni de perte de force, avec une structure musculaire préservée.
Pendant le jeûne, l’organisme active la lipolyse (utilisation des graisses), produit des corps cétoniques comme carburant alternatif et économise naturellement les protéines. Là encore, ces résultats concernent des jeûnes supervisés, chez des personnes évaluées médicalement. Toute pratique doit être adaptée au profil de chacun.